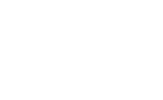Positions
Pour tout·e architecte, construire des édifices dans le monde contemporain pose un paradoxe. D’une part, il est indéniable que les modes actuels de production du bâti ne sont pas durables. Construire aujourd’hui revient à contribuer à l’exploitation des ressources terrestres et des énergies fossiles, participant ainsi à la destruction de la planète. D’autre part, refuser de construire reviendrait à abandonner cette responsabilité à d’autres acteurs, soumis à la seule loi du marché. Cela risquerait d’aggraver encore davantage la crise écologique.
Face à ce dilemme, notre position est claire : l’architecture est la seule discipline capable de formuler une critique interne de l’appareil productif. Le projet architectural doit être une opportunité pour concevoir une mise en œuvre soutenable sur les plans écologique, économique et social.
Dans cette optique, nous proposons d’étudier les qualités intrinsèques d’un matériau, en l’occurrence le bois, depuis son mode de production, ses caractéristiques ( légèreté, adaptabilité) jusqu’à sa mise en œuvre (type d’assemblage) dans un projet d’architecture. Chaque étudiant aura ainsi l’occasion, à travers son projet, d’explorer un thème spécifique en lien avec un territoire donné.
Pour ce semestre, les étudiants seront invités à interroger les conditions et les conséquences d’une hyperdensification, en concevant un bâtiment en bois à programmes mixtes sur un site parisien précis : une parcelle libre située le long du périphérique, à proximité de la rue Bruneseau dans le 13ᵉ arrondissement. Leur réflexion portera sur les dimensions techniques propres au matériau employé , programmatiques, politiques et économiques que soulève ce sujet.
L’hyperdensité ne sera pas envisagée comme une simple conséquence d’une uniformisation décontextualisée du territoire. Elle sera plutôt définie comme une opportunité de renouveau architectural et urbain, permettant l’élaboration de nouveaux systèmes organisationnels et une meilleure intégration des enjeux contemporains.