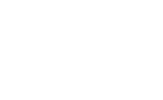Il s’agit de questionner la fabrique de la ville contemporaine en développant un regard critique sur trois dimensions :
- la façon dont les femmes et les minorités de genre vivent les espaces (publics et privés) qu’elles occupent et qu’elles utilisent ; (Ahrentzen, 2003) citant (Rothschild et Rosner, 1999)
- les théories de l’architecture, ses symboles, formes ou pratiques et de ce fait ses modèles de références en postulant qu’iels sont vecteurs des différences entre le masculin et le féminin ou entre les hommes et les femmes ;
- le travail négligé des femmes architectes.
Trois grandes questions structureront le déroulé du cours :
• La ville est-elle sexiste ? Un état des lieux
Quelles inégalités sont à l’œuvre en matière de conception architecturale et urbaine ? Comment sont produits les modèles de référence en architecture et en urbanisme ? qu'est ce qu'engage ce processus et quelles sont les images et représentations de l’espace qui en découlent ? Comment sont créés les savoirs en architecture ? Comment se produisent et se reproduisent les inégalités de genre dans et à travers la pratique architecturale ?
Deuxième partie du cours :
• La pratique ordinaire de l’espace est-elle genrée ?
Le genre en tant que concept analytique est-il pertinent pour comprendre comment la ville est parcourue et pratiquée au quotidien ?
Troisième partie du cours
• Pour une ville alternative. Quel manifeste ?
Quels outils seraient nécessaires pour se lancer dans la pratique de l’architecture pour lutter contre les inégalités de genre dans l’exercice du projet et dans la profession ?
Le travail d’équipe sera placé au centre du cours. Les séances se dérouleront en classe et plusieurs visites de terrain seront organisées.
Chaque séance donnera lieu à un travail de groupe et à une restitution collective.