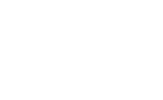(à compléter)
1. Giorgio Agamben, Homo sacer, vol. 1 Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997
2. Charles Altorffer, Traité d’urbanisme enchanteur, Lyon, Libel, 2021
3. Ariella Aïcha Azoulay, Potential History: Unlearning Imperialism, Londres/ New York, Verso Books, 2019
4. Judith Butler, Qu’est-ce qu’une vie bonne, Paris, Rivages poche, 2020
5. Michel De Certeau, L’invention du quotidien. Arts de faire, Paris, Union générale d’édition, 1980
6. Yona Friedman, L’architecture de survie : une philosophie de la pauvreté, Paris, Editions de l’Eclat, 2003
7. Vilém Flusser, Post-Histoire, Paris, T et P Work Unit/ Saint-Etienne, Cité du design, 2019
8. Pierre Frey, Learning from Vernacular : pour une nouvelle architecture vernaculaire, Arles, Actes Sud, 2010
9. Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989
10. Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Vaulx-en Velin, Les éditions des mondes à faire, 2020
11. Charles Jencks, Le langage de l’architecture post-moderne, Paris, Denoël, [1977] 1985 (4e édition)
12. Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017
13. Bruno Latour, Peter Weibel (eds.), Critical Zones. The Science and Politics of Landing on Earth, ZKM/ MIT Press, Karlsruhe/ Cambridge Ma. et London, 2020
14. Ursula Le Guin « The ones who walk away from Omelas », in Ursula Le Guin, The unreal and the real, Easthampton Ma., Small Beer Press, 2012
15. Joffrey Paillard, « Le design urbain : un dispositif disciplinaire et sécuritaire 'interstititel' ? », Sciences du Design, 2023/ 1, n° 17, p. 38-62
16. Virginie Picon-Lefèvre, Haïdar Mazen, Apprendre de l’informel, pratiques architecturales dans les villes méditerranéennes, Silvana Editoriale, Milan, 2024
17. Elizabeth Povinelli, The economy of Abandonment. Social Belonging and Endurance in Late Liberalism, Duke University Press, Durham/ Londres, 2011
18. Elizabeth Povinelli, Between Gaia and Ground. Four Axioms of Existence and the Ancestral Catastrophe of Late Liberalisme, Duke University Press, Durham/ Londres, 2021
19. Kantuta Quiros et Aliocha Imhoff, Qui parle ? (pour les non-humains), Paris, Presses Universitaires de France, 2022
20. Philippe Rahm, Histoire naturelle de l’architecture. Comment le climat, les épidémies et l’énergie ont façonné la ville et les bâtiments, Paris, Pavillon de l’Arsenal, 2020
21. Louis Rice, David Littlefield (eds.), Transgression: towards and expanded field of architecture, Routledge, Londres/ New York, 2015
22. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (édition Starobinski = 1969/ 2016), Gallimard, coll. Folio